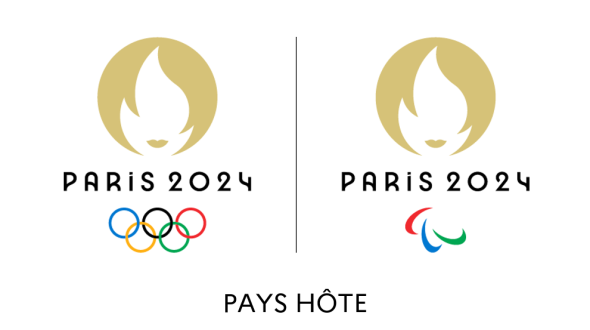Le service national de la police scientifique est dirigé par Eric Angelino (arrêté du 31 décembre 2020).
Les missions du service national de police scientifique
Le service national de la police scientifique est chargé des trois grandes missions de la chaîne criminalistique :
- les constatations et prélèvements sur le terrain ;
- les analyses en laboratoires ;
- les comparaisons dans les fichiers de police.
En apportant des indices de nature scientifique, robustes, fiables et vérifiables, la police scientifique participe à la réduction de l’incertitude des enquêteurs et des magistrats, tout au long de l’enquête.
De la mise en place de méthodologies opérationnelles aux démarches d’innovation et de développement, la police scientifique nourrit la même ambition : permettre une identification formelle de tous les auteurs d’infraction, plus rapidement.
Une organisation à deux niveaux
Le service national de police scientifique
Le service national de police scientifique (SNPS), est un service à compétence nationale issu de la fusion du Service central de la police scientifique (SCPTS) et de l’Institut national de police scientifique (INPS). Il a été créé par décret le 1er janvier 2021 et a son siège près de Lyon, à Écully.
Le SNPS a notamment pour mission de :
- Définir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer la politique de la police nationale en matière de police scientifique ;
- Réaliser tous les examens, constatations, expertises, recherches et analyses d’ordre scientifique qui lui sont demandées par les autorités judiciaires ou les enquêteurs.
Le SNPS est composé d’une direction, de 7 délégations implantées dans chaque zone de défense et de sécurité ainsi que de 5 laboratoires de police scientifique (LPS) organisés en réseau à Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse.
Les activités analytiques proposées par le SNPS couvrent la majeure partie des champs de la criminalistique (empreintes génétiques, les traces papillaires, la physique-chimie, la toxicologie, les stupéfiants, les incendies et explosions, la balistique, l’odorologie, les documents et écritures, traces numériques).
Fort de plus de 1 200 agents, majoritairement issus de la filière scientifique, le SNPS a la capacité de projeter ses unités d’intervention sur l’ensemble du territoire national et à l’international, en assistance des services locaux.
Des services de proximité implantés sur tout le territoire
Au-delà du SNPS, les services de police scientifique sont présents dans les directions départementales de police nationale ainsi qu’à la Préfecture de police de Paris.